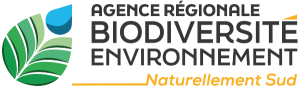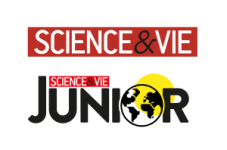La parole à Aurélie Charbonnel, actrice de la biodiversité

Aurélie Charbonnel, Chargée de mission scientifique & animation territoriale au Conservatoire d’espaces naturels de Savoie (CEN Savoie), nous présente le projet de restauration du marais des Communaux de Chindrieux afin de redonner une nouvelle vie pour le marais. Prenons-en de la graine !
Association Fête de la Nature : Quel était l’état du marais des Communaux de Chindrieux avant l’intervention du CEN Savoie ?
Le marais des Communaux de Chindrieux se situe au nord du lac du Bourget, au cœur de la plus grande zone humide de Savoie (près de 2 100 ha). Au début du XXème siècle, cette zone humide a été “assainie” pour la mettre en culture (avec des plantations de maïs et de peuplier). Un réseau de plusieurs centaines de kilomètres de drains (fossés) a été creusé pour l’assécher.

En parallèle, plusieurs aménagements ont été menés sur le Rhône pour la production hydroélectrique. Ces travaux ont modifié les apports en eau de la zone humide et ont accentué son assèchement. Le niveau de la nappe s’est abaissé, laissant l’oxygène entrer dans le sol à la place des molécules d’eau. Les micro-organismes présents dans le sol ont été activés et ont alors décomposé une partie de la matière organique disponible. Ce processus a entraîné un affaissement des pores du sol et plus globalement un tassement de celui-ci (de l’ordre de 1 mètre). En surface, le sol est devenu beaucoup plus argileux, ce qui a réduit les capacités de circulation et de pénétration de l’eau, notamment en cas de pluie ou de crue.
"La commune de Chindrieux décide de mettre en œuvre un véritable projet d’intérêt général avec la restauration et la valorisation agro-environnementale d’une parcelle de 60 ha cultivée durant plus de trois décennies en maïs..."
En parallèle, des espèces envahissantes (comme la bourdaine ou le solidage, etc.) se sont développées, en entrainant la disparition de celles emblématiques des zones humides. C’est le cas du courlis cendré, un oiseau autrefois présent dans les grandes plaines humides du territoire.
En 2015, la commune de Chindrieux décide de mettre en œuvre un véritable projet d’intérêt général avec la restauration et la valorisation agro-environnementale d’une parcelle de 60 ha cultivée durant plus de trois décennies en maïs... Tout l’enjeu était de retrouver un fonctionnement optimal de la zone humide (arrêter la dégradation du sol, restaurer les écoulements et la qualité de l’eau, accueillir une biodiversité liée aux zones humides), tout en maintenant une activité agricole qui soit adaptée et ne dégrade pas les milieux naturels.
Association Fête de la Nature : Quelles actions de génie écologique ont été menées pour la restauration du site ?
Le projet de restauration a consisté à stopper le drainage et ses effets néfastes en bouchant l’ensemble des drains présents sur la parcelle (environ 23 km) avec la couche de matériaux de surface. Des milieux aquatiques ont également été créés afin d’avoir un volume de matériaux suffisant pour combler les fossés, tout en répondant aux besoins spécifiques de certaines espèces qui vont pouvoir coloniser ces milieux.

La nature humide et tourbeuse du terrain nous a obligé à travailler avec du matériel adapté (et peu disponible en France), comme des pelles équipées de chenilles type, afin de réduire au maximum la charge au sol et éviter tout risque d'enliser une machine.
"La parcelle a été revégétalisée. Des haies et bosquets ont aussi été plantés pour diversifier les milieux et créer des continuités écologiques qui sont favorables à la biodiversité."
La parcelle a été revégétalisée au printemps 2020 avec deux types de semis : un semis de prairie certifié biologique défini en partenariat avec les acteurs du monde agricole, et un semis de graines locales sauvages récoltées dans les prairies humides naturelles voisines. Le but est de garder une végétation adaptée au sol. Des haies et bosquets ont aussi été plantés pour diversifier les milieux et créer des continuités écologiques qui sont favorables à la biodiversité.
Association Fête de la Nature : Quels changements visibles sur la biodiversité, le paysage et le milieu ont eu ces actions ?
La revégétalisation de la parcelle est encore récente mais les semis ont déjà bien levé. Un sursemis pourra être nécessaire à l’automne sur les zones où la végétation n’aura pas repris. Il faudra en revanche quelques années avant que les haies et bosquets soient suffisamment développés pour jouer pleinement leur rôle d’accueil pour la faune. Au niveau paysager, le réseau géométrique et artificiel de drains, facilement visible depuis les hauteurs de Chautagne, a disparu.

En terme de biodiversité, on remarque que depuis l’arrêt de la culture du maïs en 2015, de nombreuses espèces se sont appropriées le site. À la fin de l’hiver par exemple, un groupe de plus de 30 cigognes a fait une halte migratoire sur la parcelle. Des oies cendrées ont aussi été observées sur les plans d’eau et plusieurs couples de pies-grièches écorcheurs se reproduisent désormais sur la parcelle. C’est tout un écosystème qui va se reconstruire progressivement.
"Depuis l’arrêt de la culture du maïs en 2015, de nombreuses espèces se sont appropriées le site. C’est tout un écosystème qui va se reconstruire progressivement."
Nous avons l’espoir que les papillons Maculinea, typiques des zones humides et présents dans les prairies voisines, viennent à terme s’installer aussi sur la parcelle, car ce sont des espèces particulièrement rares et fragiles.
Association Fête de la Nature : Quel message souhaitez-vous faire passer pendant votre animation pour la Fête de la Nature ?
Le projet de restauration a suscité beaucoup d’interrogations au niveau de la population locale car il change la vision du territoire. Nous aimerions profiter de la Fête de la Nature pour faciliter la compréhension de ses enjeux et objectifs, de manière pédagogique et ludique en réalisant des manipulations et en observant la nature sur place.